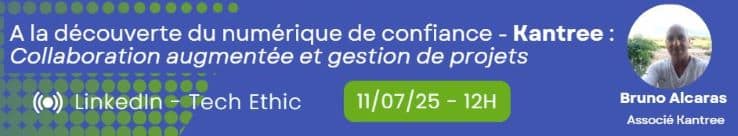Peut-on laisser l’Intelligence Artificielle se développer seule, sans contrôle supra national ?
C’est une question que chacun se pose très probablement, avec une actualité de plus en plus présente.
C’est pourquoi il est rassurant de constater que des organismes internationaux se sont emparés de la question, et en ont tiré des conclusions et des enseignements.
Qui commencent à être suivis d’annonces concrètes.
En Mars dernier, l’Unesco avait nommé un panel d’experts pour établir des recommandations concernant l’usage de l’Intelligence Artificielle.
L’UNESCO a par la suite lancé un large processus de consultations permettant d’obtenir le point de vue de nombreux acteurs issus d’horizons bien différents : experts issus de 155 pays, citoyens (via une enquête mondiale en ligne), agences des Nations Unies, et acteurs majeurs du secteur tels que Google, Facebook et Microsoft ou encore le secteur académique – de l’Université de Stanford à l’Académie chinoise des sciences -, ont pu partager leur point de vue et enrichir les conclusions du projet.
« Nous devons garder les yeux ouverts, pour que l’intelligence artificielle se développe ”à notre service, et non à nos dépens” », a averti la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay. « Nous avons besoin d’un socle robuste de principes éthiques afin que l’intelligence artificielle serve le bien commun. Nous avons souhaité que ce processus soit aussi large que possible puisqu’il s’agit bien d’un enjeu universel », a-t-elle rappelé.
Les enseignements et recommandations ont été transmis à 193 pays membres de l’organisation.
L’objectif annoncé étant de parvenir à un accord et à des mesures communes qui pourraient être adoptées en novembre 2021, lors d’une conférence générale.
Des actions concrètes seront proposées
Le projet qui sera proposé met en avant un certains nombre de mesures :
- La proportionnalité : les technologies d’IA ne doivent pas dépasser des limites préétablies pour atteindre des buts ou objectifs légitimes et doivent être adaptées au contexte de leur utilisation ;
- La surveillance et la détermination humaines : les humains sont éthiquement et légalement responsables de toutes les étapes du cycle de vie des systèmes d’IA ;
- La gestion de l’environnement : les systèmes d’intelligence artificielle doivent contribuer à l’interconnexion pacifique de toutes les créatures vivantes entre elles et respecter l’environnement naturel, notamment dans l’extraction des matières premières ;
- L’égalité des genres : les technologies d’IA ne doivent pas reproduire les écarts entre les genres existant dans le monde réel, notamment en ce qui concerne les salaires, la représentation, l’accès et la diffusion de stéréotypes. Des actions politiques, y compris en matière de discrimination positive, sont nécessaires pour éviter ces écueils majeurs.
Derrière cette volonté très louable de la part d’un organisme supranational puissant et historique, il faudra guetter les mesures concrètes et effectives qui seront adoptées.
En effet, il est à craindre, comme lors de multiples occasions par le passé, que les intérêts nationaux reprennent le dessus à la première occasion.
L’Intelligence Artificielle est un concept qui, s’il est à l’œuvre dans de nombreux pays, n’est maitrisé industriellement que par quelques uns d’entre eux. Ce sont eux, sous la pression commerciale des GAFAM ou d’autres grands du numérique et de la technologie, qui pourraient être tentés de protéger leurs intérêts commerciaux au détriment de ceux des citoyens.
D’autant, rappelons le, que les Etats Unis ou Israël se sont retirés de l’Unesco en 2019.
L’éternelle guerre entre intérêts humains et commerciaux va donc se jouer de nouveau dans les mois qui viennent, et la pression exercée par la crise du Covid19 (volonté de surveillance massive des déplacements, contacts, états de santé…) pourrait bien avoir une importance cruciale dans les choix qui seront opérés d’ici la conférence de 2021.