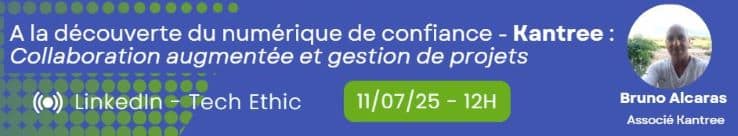Interview de Valéria Faure Muntian, Députée de la Loire, Membre de la Commission des Finances
Thierry Bayon : Bonjour Valéria Faure Muntian. La souveraineté numérique, qu’est-ce que cela veut dire pour vous? Qu’est-ce que cela vous évoque?
Valéria Faure : J’ai eu l’occasion de définir la souveraineté dans le cadre de mon rapport sur les données géographiques souveraines. Je me suis longuement penché sur le sujet. J’estime que la souveraineté n’est pas de tout savoir-faire de A à Z soi-même. On mange des kiwis et des ananas, et l’on ne sait pas forcément les produire sur notre sol.
En soit ce n’est pas bien grave, on est dans un monde ouvert et mondialisé. Il ne faut pas avoir peur de ce qui vient de l’extérieur. Par contre, il faut fixer les règles du jeu avec des normes, des choses que l’on estime acceptable ou pas, et le numérique en fait partie.
La force de l’Union européenne n’est malheureusement pas la production. Cela pour X raisons, qui sont en lien avec l’hyperpuissance américaine, mais aussi parce qu’il y des défauts de conception chez nous en Europe : les protections de notre code de concurrence, de nos modèles économiques, de nos modèles de financement, etc.
Il y a beaucoup de raisons qui font que nous n’avons pas fait émerger de géants du numérique. Mais en l’occurrence, la puissance européenne consiste à normaliser, accepter les produits venant de l’extérieur de l’union, mais sous certaines conditions. L’exemple le plus flagrant, c’est l’alimentation, mais aussi les produits manufacturés.
Nous avons le sceau CE qui est une vraie puissance.
“La force de l’Union européenne n’est malheureusement pas la production.”
Pour le numérique, nous avons le RGPD qui n’est peut-être pas quelque chose d’extraordinaire, et qui a porté certains préjudices à nos entreprises, mais qui nous permet de faire aussi un certain tri sur ce que l’on accepte sur notre territoire. Donc, la souveraineté consiste à maîtriser le modèle de production et d’utilisation, et à avoir les compétences pour savoir analyser, en ayant fixé les normes au préalable.
Pour moi c’est ça la souveraineté.
TB : Sur la dimension purement numérique, il y a différentes écoles aujourd’hui. Ceux qui disent que l’on ne rattrapera jamais notre retard sur les Américains. Et qu’il vaut mieux se spécialiser dans les domaines dans lesquels nous avons de bonnes cartes à jouer. D’autres pensent que nous avons du retard, mais qu’il faut maîtriser toute la chaîne, pour avoir une position de poids à long terme sur le marché. Et pour vous ?
VF : Il faut que nous ayons la compétence. C’est-à-dire, il faut que nous puissions décortiquer la technologie que nous achetons hors Union européenne.
TB : Quand vous dites décortiquer, cela veut dire la comprendre? L’appréhender?
VF : Tout à fait. Je prends toujours l’exemple des humoristes qui disent ” une femme blonde amène sa voiture chez le garagiste…”. Cette femme, on peut lui raconter toutes les salades possibles et imaginables, parce qu’elle ne comprend soi-disant pas ni le langage, ni la technologie. Nous ne devons pas être semblables à cette femme naïve des humoristes
Il faut que nous puissions décortiquer, que nous puissions comprendre sans pour autant produire, pour acquérir les compétences. Si nous achetons seulement des boîtes nous ne sommes pas souverain. Il faut comprendre ce que l’on achète.
Il faut investir sur nos points forts et les compétences font partie de nos points forts. Il n’y a pas une intelligence artificielle dans le monde qui est développée sans qu’un français soit dans l’équipe. Mais, nous ne savons pas le valoriser. On laisse partir les cerveaux et l’on ne produit pas les compétences de toute la chaîne de valeur. Par exemple, en bas de la chaîne de valeur numérique, les codeurs manquent à l’appel. Les ingénieurs manquent aussi à l’appel.
“Si nous achetons seulement des boîtes nous ne sommes pas souverain. Il faut comprendre ce que l’on achète.”
Ils ont tendance à partir parce que c’est plus intéressant ailleurs, pour les écosystèmes d’une part, et d’autre part pour les levées de fonds possibles pour pouvoir se développer. Notre recherche fondamentale est “vérolée” par la présence anglo-saxonne notamment américaine.
TB : Parce qu’ils co-financent certains laboratoires de recherche, donc les technologies ?
VF : Voilà. Ils influencent énormément les tendances de recherche. Du coup, là aussi sur certains points, on peut douter de la souveraineté en terme de maîtrise de compétences.
Il est vrai que lever des fonds en Europe est ubuesque. Cela n’a rien à voir avec ce qu’il est possible de faire aux États-Unis. Nous avons la recherche fondamentale, qui a du mal à devenir productive, et à s’intégrer correctement à l’industrie pour pouvoir produire à l’échelle industrielle.
Par contre, nous n’avons pas de mal à intégrer des capitaux et des volontés extra-européenne. C’est un peu le monde à l’envers, il y a une espèce d’incohérence, une forme de schizophrénie, qui est due à notre histoire. C’est la façon dont on a construit les choses en Europe et en France en particulier, au travers de la création et la montée en puissance de l’Union européenne (notre droit de la concurrence).
Il y a une logique qui explique comment nous en sommes arrivés là. Mais aujourd’hui, la façon dont nous devons projeter la France dans le XXIe siècle, n’est pas cohérente du tout. Il faut réorganiser beaucoup de choses et changer notre culture. C’est très compliqué. C’est aussi notre rôle de parlementaires de verbaliser, de l’identifier, et d’essayer de faire rentrer dans les mœurs un système de fonctionnement différent.
TB : Petit aparté, est-ce que vous croyez que le modèle du numérique français (qui s’est beaucoup développé autour des sociétés de services informatiques, les ESN) où l’on avait tendance à faire du sur mesure, perdure ? Et qu’il manque une vision marché ?
VF : C’est une culture nationale. Je donne un autre exemple, le prêt-à-porter on peut faire du luxe, du sur-mesure et on le fait très bien, mais on le fait payer très cher. Par contre, le prêt à porter quotidien nous l’achetons en Chine. Nous avons perdu les moyens de production au fur et à mesure, parce que l’on produisait mal et trop cher le tout-venant.
Donc, il ne reste que le luxe, le reste on l’achète à l’étranger. Idem pour l’alimentation. C’est trop cher, donc on sait produire du vin, du champagne, du foie gras et des truffes qu’on fait payer très cher dans le monde entier. Nous sommes sur une niche, mais tout le reste on l’achète à l’étranger.
C’est vraiment un modèle de fonctionnement. Nous l’avons vu à l’aube de la crise sanitaire avec les outils de communication à distance. C’était assez évident, j’ai eu à définir la souveraineté, je travaille sur la cybersécurité. Aujourd’hui on utilise Zoom.
Pourquoi ? Parce que là où les Américains sont forts (et les Chinois les rattrapent sur ce marché), c’est qu’ils savent faire du prêt-à-porter. Ils vous balancent une solution non aboutie, une solution qui n’est pas du tout sécurisée mais qui est ergonomique et qui s’adapte bien à tout le monde. Et donc, cela devient une référence d’usage : comme Google l’a été, comme Facebook l’a été.
Dans le cadre professionnel nous avons tendance à utiliser ce qu’on utilise tous les jours, et ça fonctionne. Le prix est plus qu’acceptable. Donc tous mes efforts durant les 6 premiers mois de la crise sanitaire pour tester toutes les solutions françaises se sont avérés être des échecs.
“…on sait produire du vin, du champagne, du foie gras et des truffes qu’on fait payer très cher dans le monde entier. Nous sommes sur une niche, mais tout le reste on l’achète à l’étranger. “
Parce qu’on fait plutôt du luxe en France. On fait des solutions lourdes, moches mais qui sont sécurisées. Cela est intéressant, mais je ne travaille pas pour les services de renseignements, je ne suis pas dans la police, dans la justice, et je ne fais pas de la haute finance.
Ce que je communique sur Zoom, le plus souvent, c’est de l’information publique. Si elle l’est pas, elle peut le devenir assez rapidement. Certes, il faut se protéger, changer ses mots de passe, faire correctement les choses. Mais j’avais besoin d’une solution où j’étais branché à mon équipe, à mes concitoyens qui étaient en crise monumentale parce qu’ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Donc oui, Zoom s’est imposé qu’on le veuille ou non.
Nous avons des solutions, nous savons produire des solutions hyper complexes. Mais seule une minorité des consommateurs est intéressée. Quand on fait de la niche, il faut savoir bien le faire. En terme de numérique, nous sommes sur la même niche que les Israéliens. Ce n’est pas la même concurrence. Ce sont des personnes qui font ça depuis les années 80, qui ont bénéficié de l’immigration Soviet avec l’école mathématiques Soviet qui n’a rien à envier à l’école mathématiques française.
On se trouve en concurrence avec des solutions peaufinées, complexes et lourdes. En concurrence avec des gens qui le font depuis plus longtemps que nous, de manière industrielle. Ils ont cette capacité à faire du marketing presque au même niveau que les Américains. Ils vont faire de l’ergonomie, ils vont faire du beau.
Quand ils ont des solutions d’échange sécurisé, c’est un mélange de Zoom de Thalès et d’Athos. On ne fait pas vraiment le poids. C’est là qu’il faut être vigilant quand nous choisissons une niche. Quel type de concurrence est présente ?
Sur du Yves Saint Laurent ou du Chanel, il est très compliqué de nous faire concurrence. Mais, ils ne sont plus souverains du tout puisque leurs capitaux sont très internationalisés. Les bénéfices (ou une partie) arrivent quand même en France. Sur le numérique, il faut faire attention parce qu’on peut rater le coche.
TB : Il y a toujours eu une assistance de l’État sur le financement du numérique. Mais on a du mal à faire acheter par ceux qui peuvent tirer la locomotive France. Au premier rang, les collectivités et l’État, mais également des grandes entreprises. Comment peut-on renverser cette tendance ? Dire : “oui on finance, mais si on finance, il faut que les Français achètent français”.
VF : L’acheteur public français est le pire acheteur public qui existe au monde. Vraiment. Encore une fois pour des raisons principalement culturelles. C’est-à-dire, on lave plus blanc que blanc. Il y a cette peur, panique, de mal acheter et de se faire taper sur les doigts par la réglementation européenne. Là où les Américains injectent, du point de vue du gouvernement, énormément d’argent par la commande publique aux solutions naissantes et/ou aux levées de fonds. Les premières levées de fonds sont assez aisées, parce que la prise de risque est différente, et la culture du risque est différente. Ils sont prêts à mettre 100 même si les retombées vont être 10. Peu importe, quelque chose va ressortir. “Je vais en arroser plein, et voir ce qui en retombe”, ça finira par tomber. Il y en a un qui finit par tomber.
TB : La commande contribue au financement continue de l’innovation ?
VF : Voilà. Donc vous avez la levée de fond et la commande. En Europe, nous avons le droit de la concurrence. Notre réglementation s’est construite sur une communauté pour pouvoir acheter hors UE ou pouvoir vendre UE. Mais avec une concurrence féroce à l’intérieur de l’UE.
“L’acheteur public français est le pire acheteur public qui existe au monde. Vraiment.”
Madame Margrethe Vestager (Vice-présidente exécutive de la Commission européenne) le dit clairement “la réussite des entreprises européennes ce n’est pas mon sujet… “. Et elle le dit publiquement, elle le dit dans toute la presse.
Elle dit encore : “moi, tout ce que je veux, c’est que l’européen puisse avoir des solutions à sa disposition, de la meilleure qualité possible et le moins cher possible”. Donc, nous avons instauré par notre réglementation européenne une concurrence féroce à l’intérieur de l’UE. Quand nous vendons nos meilleures entreprises, on les vend hors UE quel que soit l’industrie, du fait même que marier deux entreprises européennes serait contraire à un autre droit de la concurrence. De tels exemples, nous en avons beaucoup.
TB : Peut-on changer la loi, la rendre incitative pour les entreprises ? On parle des Américains qui ont leur “small business act” et qui imposent à certaines entreprises d’acheter américain à au moins 50 %.
VF : Moi, je le prône depuis que je suis élu. J’étais totalement inaudible, c’est-à-dire qu’on me riait au nez. La crise sanitaire à changé la donne.
TB : A quelque chose malheur est bon ?
VF : Oui, mais il faut que ça perdure. Entre la bonne volonté, la mise en application réelle et le temps que ça va prendre… là est le sujet. Non seulement on ne favorise pas la création de richesse en Europe, mais en plus on ajoute les nouvelles réglementations qui tapent principalement sur les Européens.
Le RGPD c’est une balle dans le pied des Européens. Le DSA et le DMA pourraient potentiellement être des textes qui vont empêcher la concentration en Europe. Sauf que si l’on devait fabriquer ne serait-ce que la moitié d’un géant, ça serait par concentration. Ça ne serait pas en partant de zéro. Ça serait par agglomération de plusieurs entreprises les unes aux autres. Donc, vigilance toujours.
Nous avons tendance à faire des textes en Europe contre les autres, mais pas pour soi. Effectivement, il y a un changement de paradigme. Ce changement on l’entend pour la première fois dans le discours de Merkel avec Macron, quand ils présentent leurs idées pour le plan de relance européen.
Quand Merkel dit “il faut que l’on revoit notre droit de la concurrence à l’heure de la compétitivité des entreprises européennes hors UE“, ça vaut de l’or.
À condition que ce soit suivi d’effet.
“Nous avons tendance à faire des textes en Europe contre les autres, mais pas pour soi.”
Le business act à l’européenne, sans se tirer une balle dans le pied. Une réglementation DSA, DMA qui aboutissent et qui n’empêcheraient pas la concentration des entreprises européennes, une capacité à faire de l’achat public privilégié.
TB : Parce que le carcan européen l’interdit ?
VF : Il l’interdit, parce que derrière on peut se prendre une énorme amende, nous en tant que pays. En plus, nous pourrions subir une amende aux États-Unis pour non-respect des droit de la concurrence. Alors même que ces règles là, sociales, environnementales pourraient figurer dans les appels d’offres pour éviter des produits hors UE ou en tout cas certains produits hors UE.
TB : Madame Merkel est partie. On ne sait pas ce que son successeur va faire par rapport à cet aspect des choses.
VF : Tout à fait. Ce qui est drôle, c’est que les Allemands savent acheter et savent faire de la préférence nationale. Ils savent rédiger leurs appels d’offres pour faire de la préférence nationale. Mais, publiquement, dans la réglementation européenne, ils vont toujours défendre la concurrence la plus féroce, parce qu’ils exportent énormément aux États-Unis et que ce poids là est non négligeable.
Tous ces aspects relèvent de la culture. Et ils sont transmis de génération en génération aux acheteurs publics, qui vont refaire les mêmes erreurs.
TB : Parce qu’il n’y a pas suffisamment de brassage ?
VF : Il y a cette peur panique de la responsabilité individuelle de celui qui signe la commande publique. Il y a cette peur de la corruption… c’est ultra courant en France.
TB : En fait, il faudrait un brassage entre le public et le privé ? Mais lorsque l’on voit des gens du public ouvrir leurs horizons pour aller dans le privé, on parle de pantouflage au mieux et de collusion.
VF : Nous avons fait des efforts avec Agnès Pannier Runacher (Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances). Nous avons relevé les plafonds d’achat public en one-to-one sans passer par la commande publique, l’appel d’offre, pour les technologies innovantes.
Je misais beaucoup sur les cyber, notamment pour les collectivités en la matière. Mais il n’y a pas cette culture là, ces habitudes là. Si l’on dépasse le montant de 40 000 € on est en panique en France. On a pléthore d’agences publiques qui sont autonomes. On a énormément d’agences parapubliques, qui bénéficient du protectorat et du financement de l’État, mais sur lesquelles nous n’avons pas de contrôle a posteriori.
Elles ont une tutelle. Mais cette tutelle ne peut pas contrôler chaque contrat. Elle contrôle la base sur laquelle travaille l’agence, mais derrière pour faire l’audit, a posteriori, c’est extrêmement complexe. En principe il se contente d’un audit interne.
“Si l’on dépasse le montant de 40 000 € on est en panique en France.”
TB : Donc, ce que vous dites c’est qu’il faut un changement culturel ? Un travail opéré en profondeur dans les entreprises, dans les collectivités pour que justement elles soient capables de comprendre les enjeux liés à l’investissement public, qui doit bénéficier à la souveraineté et au rayonnement de la France ?
VF : Tout à fait. Je pense qu’il faut intégrer, dès leurs formations, le terme souveraineté. Je rappelle qu’avant 2017, “souveraineté” était un mot populiste qui était utilisé par les extrêmes. On l’a réhabilités depuis très peu de temps. Souveraineté c’est vilain en France. Souveraineté en Europe n’est pas très bien vu non plus.
TB : Il y a un mélange entre souveraineté et souverainisme qui est compliqué à expliquer…
VF : Nous avions pris toutes les précautions en posant le cadre de la souveraineté en disant “oui mais… Pas de chauvinisme, pas ceci, pas cela..”. En fait, on définit la souveraineté par la négative au lieu de la positiver.
Si l’on a un hymne, une nation, un drapeau, une constitution, on est souverain. Le peuple est souverain. Et le peuple qu’est-ce qu’il veut ? Il veut de la visibilité, des perspectives, du protectorat et savoir de quoi son avenir est fait.
TB : Et de la transparence dans la gestion et dans les affaires de la nation ?
VF : Si on veut protéger notre peuple souverain, il faut qu’on fasse un minimum de souveraineté et un tout petit peu de souverainisme. Sinon, on est incapable de dire, par exemple, ce que mangent les français.
Pourquoi a-t-on décidé d’interdire les OGM ? C’était de la souveraineté. Sauf qu’on ne l’a pas appelé comme ça à l’époque. Et pourtant ça n’a pas été qualifié comme étant du repli sur soi. On est le seul, ou l’un des seuls pays en Europe, qui interdise la production et la consommation d’OGM. Mais on ne maîtrise pas tous les circuits, et l’on en consomme quand même sans le vouloir.
Il y a donc un problème de souveraineté, parce que quand on a fixé les règles sur les OGM en France, il restait des choses qu’on a pas su anticiper. Parce qu’on ne maîtrise pas l’OGM, parce qu’on a refusé d’en faire. Refuser d’en faire ça ne veut pas dire qu’il faut boycotter complètement la recherche fondamentale.
La problématique c’est qu’on refuse de produire de l’OGM en France. Donc les industriels disent : “ça ne va pas rapporter de l’argent puisque c’est interdit, donc je ne vais pas investir dedans”. Et les chercheurs disent “vu que je n’ai pas de moyens de tester ma recherche en réel, puisque c’est interdit, je ne vais pas choisir cette thématique de thèse. Cela ne va pas être porteur et derrière, si je veux travailler dans le privé, qui voudra de moi si j’ai travaillé sur un sujet qui intéresse personne ?”.
“…faire des J.O. en France sans reconnaissance faciale ça me sidère.”
Attention quand on interdit. Aujourd’hui nous avons la même problématique avec la reconnaissance faciale, nous n’en voulons pas.
Mais nous en avons quand même. Nous achetons des solutions israéliennes ou chinoises, donc pas très éthiques, et l’on maîtrise moyennement la technologie parce que finalement nous n’avons pas investi dedans, ni en termes de recherche, ni en termes de financement, ni en termes de compétences.
Nous sommes dans une bulle. Pardon, mais faire des J.O. en France sans reconnaissance faciale ça me sidère. Aujourd’hui, c’est imposé dans le monde entier comme l’un des critères de protection. Surtout dans un pays qui a été autant frappé par le terrorisme.
Donc que va-t-on avoir en 2024 ? L’achat massif de solutions qui viennent d’ailleurs, qui ne sont pas souveraines du tout et dont on ne maîtrise même pas le cadre correctement. Parce que nous avons refusé de faire de l’expérimentation sur le territoire, sans pour autant la déployer de manière massive. Il faut savoir faire sans faire.
On ne consomme pas d’OGM et on ne les produit pas de manière industrielle, mais on continue de faire de la recherche dessus pour maîtriser le sujet pour le jour où. On se retrouve quand même avec des vaches fécondées avec des paillettes, des taureaux nés de manière classique, mais issus d’un des parents modifiés génétiquement. Pas de sélection, la sélection à toujours été faite (on prend la plus belle vache et le plus beau taureau et on les accouple). Ici, clairement la maman de ce taureau a été génétiquement modifiée en laboratoire.
Cette traçabilité là ne va pas aussi loin. Nous avons une forme d’OGM sur le territoire parce que les paillettes arrivent et que nous n’avons pas forcément la maîtrise de ce qui a été généré au départ. Cette logique là l’interdit.
Le refus, la peur de mal acheter, la peur d’avoir sa responsabilité personnelle engagée. Pas celle de l’administration pour laquelle on travaille, mais sa responsabilité personnelle, la peur d’être taxé de quelqu’un de corrompu.
Ces interdictions brutes, sans réflexion derrière, génèrent des impasses par rapport au but qu’on cherchait à atteindre. On le met en lumière sur les technologies, l’évidence qu’il y a un truc qui cloche, mais en fait nous fonctionnons depuis toujours comme ça et sur tout. La technologie suit la même logique que tout ce que l’on faisait jusque-là en termes de réglementation, d’achat public, etc.
TB : Ce que vous dites est très intéressant. Pour conclure, quel est le rôle d’une député ? Y a-t-il des choses concrètes qu’il peut faire ?
VF : Un peu. En termes de réglementation il y a rien qui interdit de bien faire. Là où l’on était un petit peu coincé, avec les appels d’offres publics, c’est que nous avions des plafonds très bas. On les a remonté.
“Ces interdictions brutes, sans réflexion derrière, génèrent des impasses par rapport au but qu’on cherchait à atteindre.”
TB : C’est donc plus de 40 000€ maintenant ? Ça a été remonté ?
VF : Pour les nouvelles technologies, en 1er janvier 2020 nous étions à 100 000 € hors-taxe pour des solutions innovantes. Maintenant, comme tout ce que l’on fait, il faut prouver que c’est une solution innovante.
En 2021 je n’ai pas suivi l’évolution parce que j’étais accaparé par le coronavirus. Mais vous trouverez cela sur le site de Bercy (Note de Tech Ethic : le plafond n’a pas bougé en 2021) Avec la grille pour chaque prestation et type d’achat, quel type de solution, quel est le plafond… C’est une chose qui est très méconnue.
TB : Donc un travail de communication plus important à faire auprès des collectivités ?
VF : Les grandes collectivités ont une administration qui est à jour. Mais, une collectivité de taille moyenne ou de petite taille n’a pas forcément les mêmes moyens, il n’y a pas forcément un directeur général des services, etc.
TB : Et puis sur pas mal de domaines, l’État n’est pas forcément toujours le premier à être vertueux. On l’a vu par rapport aux droits du travail, etc. On l’a vu dans le passé… des exemples de CDD, multipliés comme des petits pains…
VF : Du coup, on a 2 solutions quand on est parlementaire. Comme je vous le disais la réglementation n’est pas forcément en cause.
TB : Vous n’avez pas beaucoup de prises dessus non plus, parce que cela peut se passer au niveau de l’Europe ?
VF : Tout à fait. Il faut expliquer, évangéliser, dégripper tout ça, mettre en relation l’acheteur et les solutions souveraines.
Identifier les solutions souveraines et les promouvoir, faire des conférences, des interviews sur le sujet, faire des rapports qui sont plutôt bien lus par l’administration (je crois que c’est l’administration qui lit le plus les rapports parlementaires).
Donc donner les nouvelles tendances en fait. Comme être blogueuse sur Instagram, en mode sérieux et travaillé.
TB : Et avec le gouvernement ? Avec Cédric O, vous arrivez à travailler avec lui?
VF : Nous avons de très bonnes relations. Je dois vous avouer que le covid n’a pas aidé, mais on a fait des visio régulièrement. Les difficultés sont que le ministère de Cédric O est mal connu et son périmètre est mal identifié. Il n’est pas forcément, contrairement à ce qu’on croit, monsieur start-up et solutions technologiques. Il est plutôt garant de la numérisation de l’État.
TB : Vous lui reprochez d’être Monsieur GAFAM aussi sur certains dossiers, de jouer un petit peu trop le jeu de Microsoft pour ne pas les citer ?
VF : Je ne ferai pas de commentaires. Mais c’est beaucoup plus complexe que ça.
TB : En conclusion, un petit mot optimiste sur le numérique ?
VF : Un mot d’optimiste… On va surtout être réaliste. La France et l’Europe ont des compétences intrinsèques sur une surface de jeu qui pourrait potentiellement nous donner un avantage considérable. Mais, il faut qu’on prenne les bonnes décisions au bon moment.
Nous devons élaborer des partenariats intelligents avec ceux qui ne seront pas nos ennemis économiques, ni idéologiques. Et encore plus proche avec ceux qui le sont, et qui peuvent être beaucoup plus petits, mais dont on peut bénéficier des savoir-faire, des capacités où des coûts de production, pour justement faire le bond en avant.
Pour cela, il faut que l’Europe soit vraiment intégrée, presque fédérale. La France seule en tant que surface de jeu, les moyens qu’on y met, ne font pas le poids par rapport aux géants économiques mondiaux.
“Le but ce n’est pas de faire de la start-up nation, c’est de faire les bons choix et les bons investissements.”
La technologie n’est qu’un révélateur. Par contre la technologie c’est vraiment l’avenir.
C’est là-dessus qu’il faut investir malgré le fait que la start-up nation fasse peur à nos concitoyens. Le but ce n’est pas de faire de la start-up nation, c’est de faire les bons choix et les bons investissements.
Dès aujourd’hui, pour garantir la souveraineté des générations futures. Parce que l’asservissement technologique nous l’avons déjà connu, c’est l’industrialisation de la fin du 19e début du 20e siècle européen, qui a servi absolument tout le reste du monde.
Si l’on ne prend pas le virage très rapidement au niveau technologique, d’autres puissances vont nous asservir par rapport au choix de ces technologies.
De toute façon nous vivrons avec la technologie, nous ne pourrons pas faire sans. Donc soit nous la maîtrisons, en terme de souveraineté, soit on se fait complètement embobiner et on achète ailleurs car on ne fait pas le poids.
Je discutais avec un avocat. Nous parlions d’éthique et notamment d’intelligence artificielle.
Je disais qu’il fallait fixer les règles d’éthique pour éviter des solutions qui ont été développées, par exemple dans les camps Ouïghours chinois sur le diagnostic médical.
Il m’a dit tu es bien naïve parce qu’une personne qui a une solution pour se faire soigner se fiche de savoir d’où ça vient et comment ça a été produit : le but est de survivre. Nous avons tellement peur de la mort, de la fin, qu’on sera prêt à tout.
Véhicule autonome, parce que ça fera moins de morts sur les routes, diagnostic médical parce que plus précoce en terme de prise en charge, steak développé dans des labos parce que ça fait moins de pollution… on sera prêt à tout pour survivre et ce prêt à tout fait complètement oublier l’éthique et la souveraineté.
Donc si l’on ne prend pas garde à préserver et à faire de bons investissements, on subira.
TB : Valéria Faure Muntian, je vous remercie.
|