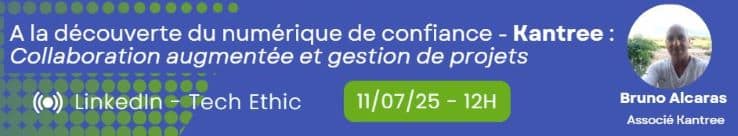C’est un sujet récurrent dans l’actualité digitale : la souveraineté numérique est désormais au coeur des débats, et suscite des actions, des mesures, des publications.
C’est l’un des sujets majeurs traité au sein de nos colonnes, et il a présidé à la création de ce site.
Pour aborder cette question de façon plus globales, nous allons publier une nouvelle série d’articles sur ce sujet, en nous appuyant sur un dossier réalisé récemment par “Annales des Mines”, avec l’institut Mines télécom, intitulé “Enjeux Numériques : La souveraineté numérique, 10 ans de débats, et après ?”.
Nous synthétiserons quelques-uns des points de vue de ce dossier, en vous renvoyant à sa lecture complète riche d’enseignements.
Voici pour commencer une introduction à cette question complexe, basé sur la contribution de Julien NOCETTI, chercheur GEODE et IFRI, à ce dossier.
La souveraineté numérique au coeur des débats
En 2023, la question de la souveraineté numérique suscite des débats variés et s’étend au-delà de son aspect technologique et industriel initial pour englober des enjeux démocratiques, socioéconomiques, de sécurité, de défense, financiers, et de formation. L’actualité est fortement marquée par ces préoccupations souveraines. Par exemple, la controverse autour de la nomination d’une experte américaine par la Commission européenne pour un poste clé dans la direction générale de la concurrence souligne un manque de sens politique et le risque d’instrumentalisation politique. De plus, TikTok est au centre de l’attention politique des deux côtés de l’Atlantique, illustrant l’importance de la régulation des plateformes numériques dans les relations de pouvoir, y compris entre alliés et adversaires géopolitiques.
La Chine est devenue une source d’inquiétude pour les États-Unis, semblant refléter les préoccupations de longue date de l’Union européenne en matière de souveraineté numérique. La réglementation européenne, notamment le Règlement général de protection des données (RGPD) et le Digital Services Act (DSA), influence le débat mondial sur la souveraineté numérique.
Le concept de souveraineté numérique a évolué au cours de la dernière décennie, passant d’un débat sur la souveraineté des États à un questionnement sur la gouvernance de l’Internet. Son importance a été renforcée par les révélations d’Edward Snowden en 2013 et la montée en puissance des grandes plateformes californiennes, qui ont mis en évidence les lacunes de l’Europe en matière de souveraineté.
De quoi parle t’on ?
Les débats sur la souveraineté numérique ont considérablement évolué au cours de la dernière décennie. Autrefois centrés sur la question de “qui contrôle internet ?”, ils ont été élargis pour englober les technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle, les réseaux 5G et la technologie quantique. En outre, des éléments tels que la maîtrise des algorithmes sensibles et l’approvisionnement en composants critiques sont devenus des préoccupations majeures.
L’extension du domaine de la souveraineté numérique a fusionné les aspects industriels et géopolitiques de manière indissociable. Cela se manifeste notamment dans le secteur des semi-conducteurs, où la Chine cherche à rattraper son retard, en particulier dans les semi-conducteurs avancés. Cependant, malgré des investissements massifs de la Chine dans ce secteur, les fabricants chinois peinent à rivaliser, en particulier pour les composants les plus sophistiqués, ce qui entraîne des importations massives de puces.
Le facteur géopolitique limite la capacité de la Chine à combler rapidement son retard, même si elle mise sur ses progrès en matière d’intelligence artificielle. En Europe, les luttes d’influence entre États pour attirer des investissements étrangers visant à relocaliser partiellement la production de semi-conducteurs illustrent la dimension géopolitique de cette question.
La souveraineté numérique n’est pas universellement comprise de la même manière. Certains États, dont la Chine et la Russie, la voient principalement comme une question de souveraineté de l’information, notamment en ce qui concerne le contenu sur le Web et les échanges de messages. Cependant, compte tenu des risques liés à la diffusion de discours haineux et de campagnes de manipulation de l’information, l’aspect “cognitif” de la souveraineté numérique ne peut plus être négligé. En fin de compte, la souveraineté numérique est liée à la défense de valeurs spécifiques.
Deux interprétations différentes
Au cours de la dernière décennie, le concept de souveraineté numérique en Europe a été interprété de deux manières distinctes.
La première interprétation est pessimiste, considérant que l’Europe est largement soumise et dépendante en matière de numérique, au point d’être qualifiée de “colonie”, de “vassale”, ou de “garde-manger de trois empires”. Cette vision souligne la perte d’autonomie politique et économique de l’Europe, en grande partie due à sa contribution à l’essor des grandes plateformes numériques non européennes et à la délocalisation de sa production, sans prendre en compte les conséquences de cette dépendance vis-à-vis de l’hégémonie américaine et de l’ascension de la Chine. Cependant, cette perspective est largement centrée sur les États, négligeant l’importance de l’autodétermination des individus, et elle tend à occulter les interdépendances caractéristiques de notre époque.
La seconde interprétation est optimiste et considère que l’Europe peut agir de manière autonome dans le domaine numérique, formulant ainsi une politique proactive. L’UE se positionne comme un acteur de la souveraineté numérique, en dépolitisant souvent cette notion pour la replacer dans le cadre du marché et du droit. L’Europe a vu la valeur de ses entreprises technologiques quadrupler au cours des sept dernières années, et elle dispose d’un grand nombre de scientifiques hautement qualifiés en intelligence artificielle, ainsi que d’un nombre significatif de développeurs de logiciels par rapport aux États-Unis. Cependant, la formation et la rétention de ces experts demeurent des enjeux cruciaux pour l’Europe afin de rivaliser avec le duopole sino-américain. La capacité de l’Europe à choisir ses interdépendances sera essentielle pour surmonter sa vulnérabilité technologique.
Pour en savoir plus :
Le dossier complet d’Enjeux Numériques – Annales des Mines N°23