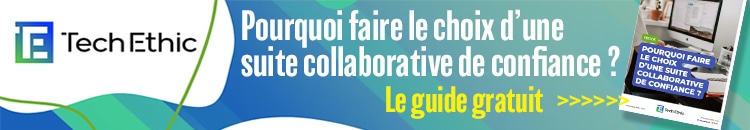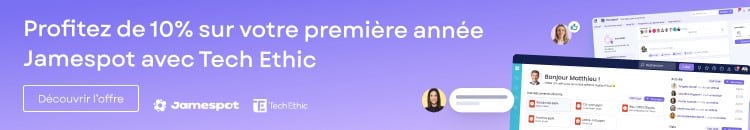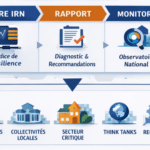Vous êtes nombreux a l’avoir suivie en direct. Mais pour ceux qui ne le pouvaient pas, voici un compte rendu de la table ronde de haut vol qui s’est tenue le 6 novembre.
- Les présentations
- Définir la souveraineté numérique
- Taxer, légiférer, ou agir ?
- Europe, cadre juridique et coopération
- Repenser les usages : la parole à Samuel Le Port
- Le plan France 2030 et les solutions européennes
- Le projet Collabnext (avec Jamespot)
- Le projet WIMI
- Le cas épineux de la DINUM
- Tour de table final
Animée par Thierry BAYON pour TechEthic, le thème en était “Les alternatives à Microsoft et à Google dans le domaine de la communication et de la collaboration”.
Cette discussion animée et constructive s’inscrit dans une série d’interviews intitulée “À la découverte du numérique de confiance”, que vous retrouverez toutes dans nos colonnes.
Etaient invités :
Le député Philippe Latombe, grand défenseur d’un numérique responsable et souverain.
Mais aussi les lauréats de l’appel à projets France numérique 2030 : Alain Garnier, CEO de Jamespot pour CollabNext et Lionel Roux CEO de Wimi qui a fédéré sous son nom différentes technologies.
Les autres invités étaient :
Philippe PINAULT, CEO de Talkspirit
Marc Oehler, CEO d’infomaniak | The Ethical Cloud
Ludovic Dubost, CEO de XWiki SAS
Philippe Vial-Grelier, CEO de Alinto
Samuel Le Port, CEO de Treebal
Ophélie Coelho, chercheuse en géopolitique du numérique
Vous pouvez retrouver l’intégralité des échanges dans la vidéo ci-dessous.
Mais aussi lire un résumé des interventions des différents invités dans le texte qui suit.
2:30 -> 10:30 :
Thierry Bayon présente les participants :
autour du député Philippe Latombe, plusieurs dirigeants d’entreprises françaises et européennes de la tech — Alain Garnier (Jamespot), Lionel Roux (Wimi), Philippe Pinault (Talkspirit), Ludovic Dubost (XWiki), Philippe Vial-Grellier (Alinto) et Marc Oehler (Infomaniak). Deux autres intervenants doivent rejoindre plus tard la discussion : la chercheuse Ophélie Coelho et Samuel Le Port (Treebal).
Les présentations
Philippe Latombe, député de la Vendée, ouvre le tour de table :
« Je travaille sur les questions numériques depuis 2017 : RGPD, souveraineté, résilience, et aujourd’hui la transposition de NIS 2 et DORA. Ces textes doivent alerter tout le monde : ils dessinent notre capacité à être résilients.»
Alain Garnier, fondateur de Jamespot :
« Jamespot, c’est une suite de collaboration numérique avec 300 clients et 400 000 utilisateurs. Nous remplaçons parfois Microsoft dans des contextes stratégiques. Je représente aussi la filière au Comité Stratégique de Filière (CSF) des outils collaboratifs. L’objectif est clair : que la souveraineté numérique européenne reprenne du poil de la bête. »
Pour essayer la solution, voici le lien à suivre.
Lionel Roux, PDG de Wimi :
« Wimi est une suite collaborative souveraine soutenue par l’État dans le cadre de France 2030. Notre promesse, c’est une alternative complète à Office 365 ou Google Workspace, enrichie d’une dimension de sécurité renforcée : chiffrement de bout en bout, filigrane, tatouage numérique. »
Pour essayer la solution, voici le lien à suivre.
Philippe Pinault, cofondateur de Talkspirit :
« Nous éditons une suite de communication et de gouvernance, utilisée par 800 clients. Au-delà du fonctionnel, nous misons sur la qualité d’expérience utilisateur, essentielle à l’adoption. »
Pour essayer la solution, voici le lien à suivre.
Ludovic Dubost, créateur de XWiki et de CryptPad :
« XWiki est un logiciel collaboratif open source de knowledge management, alternative à Atlassian Confluence. CryptPad, lui, est une plateforme d’édition chiffrée de bout en bout. Nous faisons partie des suites souveraines soutenues par la France et travaillons aussi avec l’Allemagne sur le projet OpenDesk et le projet Hexagone. »
Pour essayer la solution, voici le lien à suivre.
Philippe Vial-Grellier, représentant Alinto :
« Nous sommes spécialistes de la messagerie souveraine depuis 25 ans, avec 600 clients. La messagerie est un point de vulnérabilité critique : nos services garantissent la sécurité et l’assistance, contrairement à des géants comme Google qui restent injoignables en cas d’incident.»
Pour essayer la solution, voici le lien à suivre.
Marc Oehler, directeur général d’Infomaniak, conclut ce tour :
« Infomaniak, société suisse de 30 ans, développe la KSuite, équivalente à Microsoft 365 ou Google Workspace, ainsi qu’un cloud public concurrent d’AWS et d’Azure. Nous voulons démontrer que des produits locaux peuvent répondre à tous les besoins des entreprises européennes.»
Découvrir Infomaniak .
Définir la souveraineté numérique
Thierry Bayon :
« Avant d’aller plus loin, prenons le temps de définir ce que recouvre la souveraineté numérique. »
11:00 -> 14:40 :
Philippe Latombe :
« Quand j’ai commencé à parler de souveraineté numérique en 2021, on nous prenait pour des rêveurs : “Le numérique n’a pas de frontières !” Aujourd’hui, on parle plutôt d’autonomie stratégique : la capacité à être maîtres de certaines briques essentielles. Pour l’IA, par exemple, sans données ni cloud, pas d’autonomie possible. Le data center, la fabrication des puces, le code : ce sont des éléments vitaux. L’autonomie stratégique, c’est pouvoir continuer à fonctionner si un fournisseur américain nous coupe l’accès. »
14:40 -> 19:15 :
Alain Garnier rebondit :
« Ne pas être autonome, c’est subir. Regardez la CPI, privée d’accès à ses outils américains. C’est aussi une dépendance économique : Microsoft et Google imposent des hausses de prix de 20 à 100 %. Nous n’avons ni concurrence ni choix. Et c’est enfin une dépendance juridique : le Cloud Act ou le Patriot Act permettent aux États-Unis d’imposer leur loi extraterritoriale. Les dirigeants doivent comprendre : si l’on ne maîtrise pas nos outils collaboratifs, on ne maîtrise rien. »
19:20 -> 21:30 :
Lionel Roux précise :
« Au-delà de l’autonomie, il y a la question de la confidentialité. Les États-Unis ont légalisé, dès Clinton, la coopération de leurs agences (CIA, NSA) pour favoriser leurs entreprises. La guerre économique est là, depuis longtemps, et elle permet la récupération légale de données sensibles pour remporter des marchés. »
21:30 -> 25:50 :
Ludovic Dubost ajoute :
« Aux États-Unis même, la méfiance grandit. Après l’élection de Trump, les inscriptions sur les plateformes chiffrées ont explosé. Si les Américains craignent leur propre gouvernement, pourquoi nos données européennes y seraient-elles plus sûres ? »
Il poursuit : « La souveraineté, c’est le choix et le contrôle. Aujourd’hui, nous n’avons plus ni l’un ni l’autre. Les monopoles décident pour nous. Atlassian, par exemple, a supprimé ses versions “on premise” : d’ici 2029, il sera impossible d’utiliser leurs logiciels ailleurs que sur AWS. Le contrôle se perd aussi dans l’évolution des logiciels : personne ne peut influencer Microsoft. Le problème, ce n’est pas seulement la nationalité des acteurs, c’est le monopole. »
26:00 -> 27:00 :
Philippe Vial-Grellier renchérit :
« La souveraineté, c’est aussi la stabilité. Les protocoles doivent être ouverts, documentés et non régressifs. Une API supprimée, et tout un écosystème s’effondre. »
27:00 -> 27:50 :
Philippe Pinault ajoute :
« Et il faut pouvoir sortir librement d’un système. Les Américains ont bâti leurs empires sur le “lock-in”. La souveraineté, c’est la liberté de migrer ailleurs. »
27:50 -> 30:30 :
Philippe Latombe reprend :
« Nous sommes en pleine guerre de l’extraterritorialité. Les procureurs américains ont récemment intimé à Meta de ne pas respecter les lois européennes, sous peine de sanctions. Le RGPD, c’est bien, mais il ne sert à rien sans puissance économique pour l’appliquer. La taxe sur les services numériques, qu’on évoque souvent, pourrait servir à rééquilibrer les choses, à condition d’assumer ses effets. »
30:30-> 33:00 :
Marc Oehler enchaîne :
« Les pressions ne sont pas seulement économiques : elles peuvent devenir géopolitiques. Demain, l’administration américaine pourrait bloquer l’accès d’entreprises européennes à leurs services. En parallèle, l’Europe perd son tissu d’entreprises locales : jadis, 20 hébergeurs autour de Genève ; aujourd’hui, presque plus aucun. Nous sommes devenus les commerciaux de Microsoft. Et plus on attend, plus il sera difficile de revenir en arrière. »
Taxer, légiférer, ou agir ?
34:40 :
Thierry Bayon relance : faut-il taxer les GAFAM ?
35:00 :
Marc Oehler :
« Je ne crois pas à la taxe. Il faut gagner sur le produit : proposer des outils désirables. Forcer les utilisateurs, ça ne marche pas sur le long terme. »
35:40 :
Philippe Vial-Grellier :
« La guerre des prix ne nous serait pas favorable : les GAFAM peuvent vendre à perte pendant des années. En revanche, l’État peut jouer un rôle dans l’éducation et la commande publique. »
36:30 :
Alain Garnier :
« Il n’y a pas de solution unique. Il faut une multithérapie : commande publique, fiscalité, formation, et promotion des solutions existantes. Le problème n’est pas l’absence d’offre européenne, c’est qu’on ne la met pas en avant. Le rôle de l’État est de flécher ses achats et d’imposer des usages alternatifs dans l’administration. »
40:40 :
Ludovic Dubost :
« Je suis favorable à une taxe, mais elle doit être réinvestie dans les solutions souveraines. Taxer les monopoles n’est pas une punition : c’est un rééquilibrage. Et il faut aussi obliger l’interopérabilité : pouvoir exporter ses données, imposer des formats standard, casser les verrous techniques. »
42:40 :
Philippe Latombe nuance :
« En France, la Constitution interdit d’affecter une taxe à une dépense précise. Donc rien ne garantit que cet argent reviendrait à la filière. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que la commande publique ne joue pas son rôle. On subventionne la création de solutions, mais on ne les utilise pas. Résultat : les administrations choisissent “Bleu”, une offre française en apparence, mais sous technologie Microsoft ! »
45:10 :
Philippe Pinault conclut cette séquence :
« Le meilleur levier, c’est la confiance. Si l’État nous fait confiance, les entreprises suivront. L’enjeu, c’est de devenir crédibles et visibles. »
Europe, cadre juridique et coopération
Une question du public évoque le sommet franco-allemand sur la souveraineté numérique.
46:30 :
Philippe Latombe :
« Ironie du sort : j’ai été invité par les Allemands, pas par les Français. Sur 800 participants, 600 sont allemands. Cela dit, la coopération est essentielle. Les Länder sont très sensibles à l’usage d’outils non-américains. Nous avons intérêt à consolider un partenariat franco-allemand sur l’autonomie stratégique numérique. »
Le débat glisse vers la régulation européenne : RGPD, Digital Markets Act (DMA), Digital Services Act (DSA), Cloud Sovereignty Framework.
49:30 :
Alain Garnier :
« Le cadre juridique actuel est insuffisant, parfois contre-productif. La “circulaire cloud” française a conduit à l’émergence du projet Bleu, c’est-à-dire du Microsoft hébergé chez Capgemini : tout l’inverse d’un cloud souverain. Le Cloud Sovereignty Framework européen, lui, est plus clair avec ses niveaux de 0 à 4 ; mais quand passera-t-on à l’action ? »
53:00 :
Ludovic Dubost tempère :
« Les régulations ont quand même des effets. L’ouverture des App Stores imposée à Apple est un tournant. Le RGPD, malgré ses lourdeurs, a fait évoluer les mentalités. Mais il faut des textes simples : la complexité favorise toujours les grands. J’aimerais qu’on adapte les obligations à la taille des entreprises : qu’on n’écrase pas les innovateurs sous la même bureaucratie que les géants. »
55:00 :
Philippe Latombe complète :
« Encore faut-il que l’État sache ce qu’est une “donnée sensible”. Aujourd’hui, chaque ministère a sa propre définition. Tant qu’on n’aura pas clarifié ça, les règles resteront inopérantes. »
Repenser les usages : la parole à Samuel Le Port
57:00 :
Arrivé en cours de discussion, Samuel Le Port, fondateur de Treebal, prend la parole :
« Treebal est une messagerie souveraine pensée pour les organisations. Contrairement aux acteurs hégémoniques, nous ne cherchons pas à capter les données. Ce qui m’intéresse, c’est la qualité du dialogue dans les entreprises, la sobriété et le sens. Les organisations sont aujourd’hui noyées sous WhatsApp : un salarié qui part emporte les conversations. Nous voulons redonner la maîtrise de la communication. »
1:00:20 :
Philippe Latombe salue l’approche :
« C’est exactement le type d’exemple à mettre en avant. Nous devons promouvoir les réussites, pas seulement dénoncer les dépendances. »
1:01:15 :
Samuel Le Port :
« On ne gagnera pas par la régulation seule ni en copiant les Américains. Il faut inventer un numérique européen, conforme à nos valeurs et à notre culture. C’est par le sens et la qualité des usages que nous reprendrons le contrôle.»
1:02:00
Thierry BAYON
Relance Philippe Latombe sur une tribune parue dans Le Point, où celui-ci plaidait pour une révision profonde du Crédit Impôt Recherche. Thierry Bayon résume : plus de 80 % du CIR va aujourd’hui à des entreprises de plus de 250 salariés, essentiellement des multinationales qui n’en ont souvent pas besoin. Il demande au député de développer sa proposition d’inverser la logique pour flécher 80 % des fonds vers les TPE, PME et ETI.
1:05:15
Philippe LATOMBE
Il rappelle que le CIR représente une masse d’argent public « très importante », mais « relativement mal distribuée » : l’essentiel va aux grands groupes, alors que les plus petites entreprises ont justement besoin d’accompagnement. Le dispositif est en outre « compliqué à aller chercher », ce qui génère un marché d’intermédiaires — cabinets de conseil et autres — prenant « 10 à 15 % du CIR obtenu ».
Il pointe aussi les contrôles administratifs : « parfois très compliqués, très intrusifs et mal fichus », car menés par des inspecteurs qui « ne comprennent pas grand-chose à l’innovation ». D’où sa proposition d’« inverser les choses » pour rediriger la majorité du CIR vers les petites structures.
Il propose également deux mécanismes nouveaux :
- Un amortissement du CIR en cas de rachat par un acteur non européen : si une entreprise ayant touché du CIR est rachetée par un groupe américain ou chinois deux ans plus tard, elle restituerait alors la part correspondante au prorata, par exemple 50 % si l’amortissement est sur quatre ans.
- Un malus sur le CIR lorsque l’entreprise distribue des dividendes : si une entreprise distribue 20 % de son résultat en dividendes, son CIR serait réduit d’autant. « Le crédit impôt recherche n’est pas là pour financer la rente, mais pour financer la recherche, l’innovation et l’avenir. »
Pour lui, ces ajustements seraient autant un moyen d’économiser une partie des dépenses publiques qu’un levier pour réorienter le soutien vers les acteurs réellement innovants — les TPE, PME et ETI. Il insiste : beaucoup d’innovation se fait dans les petites structures, qui sont en plus « peu délocalisables ».
1:07:30
Thierry BAYON
Evoque le plan France 2030. Il rappelle que plus de 19 000 entreprises numériques ont bénéficié d’une aide France 2030. Il interroge : ne risque-t-on pas d’« arroser trop large » et de saupoudrer les financements ?
1:08:00
Philippe LATOMBE
Il reconnaît que de nombreuses entreprises autour de la table ont certainement bénéficié de ces aides, mais il défend l’idée que le sujet est avant tout budgétaire : « vu l’argent que nous n’avons pas », il faut faire des choix. Il reconnaît que la logique France 2030 a pu favoriser le « saupoudrage ».
Selon lui, la question centrale est désormais d’établir des priorités, de cibler les projets et d’éviter de financer simultanément 19 000 entreprises lorsque les ressources sont limitées.
1:09:30
Samuel LE PORT (Treebal)
Il fait remarquer que l’on n’a pas besoin seulement de subvention, mais aussi de cas d’usage. Il souhaite développer les usages et être dans la co-construction.
1:10:00
Philippe LATOMBE
Il indique que cela a été fait et tenté, mais que cela est extrèmement complexe et demande beaucoup d’énergie. Par ailleurs, écarter une solution américaine n’ouvre pas forcément la porte à une solution française.
1:10:35
Samuel LE PORT (Treebal)
Il fait remarquer que les acteurs ont besoin d’un coup de pouce ou un élan, pour favoriser l’équipe de France du numérique, car on a aujourd’hui la capacité de choisir ces solutions.
1:11:15
Philippe LATOMBE
Il répond que cela passe par un petit nombre de personnes, qui sont décisionnaires, et que ces interlocuteurs changent rapidement, obligeant à réouvrir une discussion.
1:11:50
Ludovic DUBOST (XWiki)
Il rebondit sur l’idée d’« équipe de France du numérique ». Il dit comprendre l’intention mais exprime une gêne : le réflexe franco-français lui paraît trop limité. Il préfère parler d’« équipe d’Europe du numérique ».
Pour lui, la bataille ne peut être gagnée qu’à l’échelle du continent, en nouant des alliances industrielles plus larges. Il rappelle que la France reste un pays de 65 à 70 millions d’habitants, là où l’Union européenne représente un marché beaucoup plus vaste. Il insiste :
- les entreprises européennes doivent coopérer ;
- il faut dépasser la logique strictement nationale ;
- il faut reconnaître les réussites étrangères lorsqu’elles sont exemplaires ;
« achetons européen » plutôt que d’enfermer le débat dans le patriotisme économique.
Il se dit fier de participer au projet allemand OpenDesk, parce qu’il s’agit d’un véritable projet européen. Sa propre société a été pensée dès le début comme internationale, l’objectif étant de proposer « de bons produits au niveau mondial ».
1:15:10
Ophélie COELHO
Thierry Bayon lui propose d’ouvrir un sujet stratégique : les câbles sous-marins et, plus largement, l’infrastructure physique du numérique.
Ophélie Coelho explique que le secteur des câbles est devenu, en dix ans, un point névralgique de la souveraineté numérique. Historiquement, il s’agissait d’un modèle de copropriété entre opérateurs télécoms. Désormais, les géants du numérique — en particulier Google — possèdent des câbles entiers en propriété exclusive : 32 câbles, dont la moitié en propriété unique. Une situation « totalement inédite ».
Elle analyse cela comme une transformation profonde de la chaîne de valeur : Google, comme d’autres GAFAM, contrôle désormais toutes les couches du numérique :
- logiciels,
- infrastructures physiques,
- réseaux (Google Fiber),
- semi-conducteurs,
- énergie.
Elle décrit cette montée en puissance comme une « matrice de pouvoir » extrêmement structurante. Selon elle, la dépendance ne doit pas être pensée uniquement au niveau de la bureautique ou du cloud, mais sur l’ensemble de la chaîne.
Elle indique que la souveraineté européenne est plutôt “éclatée” pour le moment, qu’il manque un petit peu de cohérence.
1:18:50
Philippe LATOMBE
Il approuve la notion de l’éclatement, même si ça va mieux. il met en avant l’idée de chasser en meute qui progresse. Il prend l’exemple de la collaboration qui fonctionne bien dans le domaine spacial en Europe, avec Thalès.
Il rejoint l’idée qu’il faut un travail en commun au niveau européen.
1:20:30
Thierry BAYON
Il interroge sur l’augmentation de capital d’Eutelstat, avec d’autres acteurs. Bonne nouvelle pour notre indépendance stratégique et numérique ?
1:20:45
Ophélie COELHO
Elle rappelle d’abord que la question des alternatives doit se penser sur toutes les couches du numérique, y compris les couches physiques comme les satellites. Elle souligne ensuite qu’il existe depuis deux ans une accélération des projets européens — IPCEI, PEPR, initiatives nationales — mais que ces programmes avancent encore trop en silo, sans cohésion réelle entre États, laboratoires et industrie.
Elle dit que l’Europe doit développer une vision collective plutôt que de fonctionner en archipel, et qu’il faut même penser au-delà du continent, en termes de “pays cœur” : les États-Unis et la Chine sont des pôles technologiques, tandis que d’autres pays — comme les Émirats — deviennent des pôles économiques. À l’inverse, l’Europe se retrouve souvent territoire périphérique, simple « comptoir » technologique, et doit retrouver du pouvoir d’influence.
Elle estime qu’il faut aussi chercher des alliances hors d’Europe, avec d’autres régions périphériques : l’Inde, de nombreux pays africains, ou encore l’Amérique du Sud, très dynamiques sur le plan logiciel.
Mais avant cela, elle insiste sur la nécessité de s’accorder en Europe, en mettant en commun les points forts de chaque pays. Elle note que Danois, Allemands, Français et d’autres excellent sur des briques différentes : « faisons corps là-dessus ».
Enfin, elle avance qu’il faudra peut-être accepter à terme une orientation technologique commune. Selon elle, certains composants open source s’imposeront naturellement et permettront de réduire la dispersion logicielle actuelle, afin de retrouver une fluidité d’usage comparable à celle des grandes plateformes.
Le plan France 2030 et les solutions européennes
1:24:30
Thierry BAYON
Thierry Bayon rappelle qu’un plan France 2030 a été lancé avec un objectif clair : « maîtriser les technologies numériques souveraines et sûres ».
Il explique qu’à l’intérieur de cet objectif, un domaine stratégique avait été défini : celui des suites bureautiques collaboratives cloud, doté d’une enveloppe de 23 millions d’euros. Cette somme a été répartie entre trois collectifs : un collectif mené par Jamespot, et un autre mené par Wimi, et un dernier non représenté aujourd’hui, chacun fédérant plusieurs acteurs autour d’eux.
Il dit que l’intention du plan était explicite : permettre l’émergence d’alternatives pérennes et efficaces aux suites de Microsoft et de Google, et soutenir des solutions capables de constituer de véritables suites bureautiques collaboratives souveraines.
Le projet Collabnext (avec Jamespot)
1:26:00
Alain GARNIER ( Jamespot – CollabNext)
Il explique que France 2030 a permis de faire émerger de vraies plateformes, capables d’avoir un « effet plateforme » comparable à celui des acteurs américains. Il présente rapidement Collabnext, le projet qu’il a piloté, en rappelant que l’enjeu était de réunir « plus d’une dizaine d’acteurs » pour obtenir une plateforme unifiée, car aucun éditeur français isolé ne pouvait atteindre seul le niveau fonctionnel attendu.
Il dit que Collabnext permet aujourd’hui de proposer une alternative complète, européenne, déployée sur le marché, et que Jamespot porte désormais un « espace de travail numérique européen », en cohérence avec une vision continentale. Il insiste sur le fait que la plateforme couvre toutes les capacités d’une suite moderne : édition collaborative, gestion de projet, messagerie interne, et désormais une brique d’IA d’entreprise intégrée grâce à l’acquisition de SafBrain.
Il rappelle que Jamespot est 100 % souverain et 100 % fonctionnel, mais pas un simple « copié-collé » des suites américaines : Jamespot reste une solution modulaire, adaptable à la maturité de chaque entreprise. Il rejoint Ophélie Coelho sur l’idée que certains standards open source émergent : par exemple, la convergence autour de Jitsi pour la visio, ou la compatibilité native de leur drive avec Nextcloud. Il croit beaucoup à ces « standards de fait » qui structurent l’écosystème.
Il ajoute que ce que recherchent les clients, c’est une alternative complète et unifiée, avec un opérateur unique pour le support, la sécurité, la distribution et les services associés. Il rappelle que Jamespot s’appuie sur un réseau d’une centaine de partenaires, car un logiciel n’est pas seulement un produit : « c’est une chaîne de valeur complète de services ».
Il souligne que la sélection de Collabnext dans France 2030 a été extrêmement compétitive et qu’elle a permis de franchir un cap structurant. Aujourd’hui, le marché s’accélère : l’année en cours est celle de la commercialisation, les ventes progressent, les entreprises veulent sortir des GAFAM, et les mécanismes d’import automatique rendent la migration depuis Microsoft beaucoup plus fluide.
Il affirme que Jamespot dispose même de fonctionnalités supérieures à celles de Microsoft : un intranet plus intelligent, un réseau social plus performant, une IA plus souveraine et plus agréable que Copilot. Il rappelle que la société existe depuis 15 ans : « si on n’était pas meilleurs dans plein de domaines, on n’existerait même pas ».
Pour lui, l’objectif est désormais de devenir les meilleurs sur toute la plateforme, et de continuer à grandir collectivement, avec diversité et compétition : « on a besoin de cette diversité des offres ».
Le projet WIMI
1:32:25
Lionel ROUX (Wimi)
Lionel Roux explique que la démarche de Wimi est similaire à celle de Collabnext, mais avec une stratégie différente : comme Wimi était déjà engagé dans un processus de qualification cloud sur un produit bien défini, l’entreprise a choisi d’intégrer des sociétés complémentaires plutôt que d’assembler plusieurs solutions. L’objectif était de renforcer leur suite plutôt que de la démultiplier.
Il annonce qu’un rapport indépendant, attendu d’ici la fin de l’année, comparera Microsoft 365 et Wimi et montrera que « l’écart fonctionnel est infime ». Selon lui, le problème n’est plus la fonctionnalité : les solutions françaises ont rattrapé Microsoft, et même dépassé l’américain sur certains points comme le chiffrement ou la gestion de projet.
Il dit que le véritable frein est culturel et politique : les dirigeants sont habitués à Microsoft depuis leurs études, et certains sont « très mal à l’aise » lorsqu’ils doivent justifier ce choix devant des parlementaires, surtout lorsque cela contredit la doctrine « Cloud au centre ». Pour lui, sortir de Microsoft demande aujourd’hui « du courage ».
Il estime donc que le débat dépasse la technologie et devient réglementaire : définir clairement ce qu’est une donnée sensible, interdire son exposition à des juridictions étrangères, et ainsi donner un cadre qui aiderait les acteurs français à atteindre une taille critique.
Il se réjouit de la concurrence saine avec Collabnext, qui fait progresser tout l’écosystème, et reconnaît que France 2030 a « considérablement accéléré » la R&D. Mais il ajoute que les aides ne couvrent qu’environ la moitié des coûts réels, et qu’une fois l’équipe renforcée, « il faut que la demande suive ». Il souligne que trois acteurs ont été financés pour atteindre le niveau d’Office 365, mais que la commande publique et la sphère étatique ne suivent pas encore.
Il conclut que la priorité désormais est que la demande émerge réellement.
Le cas épineux de la DINUM
1:37:10:
Thierry BAYON
Thierry Bayon introduit un nouveau sujet en évoquant la DINUM, qui développe une suite numérique collaborative pour les agents publics. Il rappelle qu’une tribune publiée récemment dans Les Échos par France GTFCH, un collectif de 23 éditeurs travaillant avec les collectivités, critique sévèrement cette démarche de l’État.
Il cite le passage central de la tribune : « Sous prétexte de souveraineté numérique, l’État multiplie les développements maison coûteux et inefficaces. Cette stratégie engloutit l’argent public et tue l’industrie française du logiciel en la privant de son principal débouché. »
Il utilise cette citation pour poser une question directe, notamment à Ophélie Coelho : est-ce vraiment le rôle de l’État de développer ses propres suites logicielles, ou faut-il laisser ce travail au secteur privé ?
1:38:25::
Ophélie COELHO
commence par dire que la question « faut-il que l’État développe ou laisse faire le privé ? » n’est pas la bonne manière de poser le problème. Elle explique que la suite de la DINUM est née d’un besoin ancien et très concret : permettre enfin un outil commun interministériel, là où l’administration utilisait jusqu’ici une multitude de solutions hétérogènes, sans passerelles simples.
Elle rappelle que la DINUM a testé plusieurs produits du marché, et continue même d’en utiliser certains. La suite n’est donc pas une opposition au privé, mais une réponse à un besoin spécifique de cohérence interne à l’État.
Elle dit que certaines briques de la suite sont bien des développements de la DINUM, mais dans une logique de logiciel ouvert, avec l’idée que ces briques puissent être réutilisées par les éditeurs privés, dès lors qu’elles sont utiles ou performantes. Elle rappelle par exemple que le module Doc — qui a fait couler beaucoup d’encre — n’est pas du tout un équivalent d’Office, mais un outil plus proche de Notion, qui ne répond pas aux mêmes usages et ne concurrence pas frontalement les suites bureautiques classiques.
Elle affirme que le débat a été mal posé et trop politisé, alors qu’il s’agit en réalité d’une démarche qui peut créer de la valeur pour tout l’écosystème : une base commune, ouverte, partageable, sur laquelle administration et éditeurs peuvent travailler.
Elle insiste aussi sur le fait que l’État ne développe quasiment jamais ses propres outils : la DINUM est l’un des rares endroits où il existe encore un peu de maîtrise technologique. En dehors de cela, les ministères ont surtout tendance à externaliser vers de grands cabinets de développement. La suite, au contraire, est construite par des développeurs indépendants ou des agents publics, et non par les grands cabinets habituels.
Elle conclut que c’est un faux débat de faire de ce sujet un symbole contre « l’État développeur », et que la logique de la suite peut au contraire renforcer l’écosystème privé en fournissant des socles ouverts et mutualisables.
01:41:45:
Ludovic DUBOST (XWiki)
Il intervient pour corriger plusieurs points.
Selon lui, Doc n’est pas un équivalent de Notion : il en est « très loin », tant sur les fonctions que sur la maturité. Il explique que Doc ressemble surtout à un pad collaboratif, éventuellement destiné à évoluer, mais qui n’atteint ni les capacités de Notion, ni celles de Confluence — alors même que la DINUM le présente comme une alternative. Il rappelle qu’il n’existe même pas d’outil d’import Confluence, ce qui en fait malgré tout un concurrent direct pour XWiki ou CryptPad.
Il insiste sur un point essentiel : la DINUM peut choisir de développer en open source, mais elle aurait pu le faire avec les entreprises, en partenariat. Il dit qu’il l’a proposé, que des discussions ont eu lieu, mais que cela n’a pas été retenu. Il cite l’exemple allemand d’OpenDesk, où l’État travaille directement avec des éditeurs, preuve que c’est possible.
Pour lui, la grande erreur stratégique de la DINUM est de ne pas comprendre que les logiciels — open source ou non — ont besoin d’entreprises pour les porter, les maintenir et les faire évoluer. Il affirme que l’idée selon laquelle « on développe des briques open source et le marché les reprendra spontanément » est illusoire. Les logiciels nécessitent des équipes permanentes, un modèle économique, une gouvernance, et des acteurs capables de les commercialiser.
Il prévient qu’en l’état, les modules de la DINUM risquent d’être repris surtout par des sociétés de services, attirées par la visibilité offerte par l’État, mais que ce ne serait pas une bonne chose : sans éditeurs solides pour porter ces outils, l’écosystème restera fragile. Il conclut que la réussite passe par une véritable alliance public–privé, et espère que la DINUM saura évoluer dans ce sens.
1:45:00:
Alain GARNIER (Jamespot)
Il réagit vivement en disant qu’il y a aujourd’hui un conflit ouvert entre la filière logicielle et la DINUM, et que ce n’est pas « une opportunité » pour le secteur, contrairement à ce qui est parfois présenté. Il souligne qu’un très large consensus existe : le Comité stratégique de filière, la DGE et Numéum ont tous affirmé que les développements internes de la DINUM ne sont pas bénéfiques pour l’écosystème. Pour lui, il est impossible d’affirmer le contraire alors que « toute la filière dit que ce n’en est pas une ».
Il prend l’exemple de XWiki pour illustrer l’incohérence de la situation : Ludovic Dubost est présent dans tous les grands consortiums France 2030, participe au projet allemand OpenDesk, est reconnu partout… sauf à la DINUM. Il dit que cela révèle un problème de gouvernance, pas une question de compétence.
Il ajoute que, contrairement à ce qui est parfois affirmé, la DINUM fait bel et bien travailler de grands prestataires, via des plateformes comme Malt, mais aussi via des sociétés comme Octo — désormais propriété d’Accenture. Selon lui, une analyse fine du budget de la DINUM montre qu’une part non négligeable de l’argent finit dans les mains de grands cabinets, même si des indépendants interviennent aussi.
Il affirme que la DINUM ne suit pas la logique de filière, et que si ces développements étaient réellement une opportunité, l’ensemble du secteur l’aurait déjà reconnu. Il appelle désormais à « passer à autre chose » et dit attendre ce qu’il appelle une « DINUM 4 » : une version de la DINUM qui travaillerait avec la filière, se concentrerait sur son rôle régalien, et cesserait de se substituer aux éditeurs privés.
Il estime que la stratégie actuelle revient à une forme de modèle soviétique, où l’État pense pouvoir développer mieux que les entreprises, alors que la logique économique et même la Constitution affirment l’inverse : lorsqu’il existe des offres sur le marché, l’État ne doit pas développer en concurrence avec elles.
Pour lui, il faut arrêter de dire que cette démarche est une opportunité si aucun acteur de la filière ne le constate dans les faits, et reconnaître clairement les limites économiques et industrielles du choix actuel.
1:49:00:
Philippe LATOMBE
Philippe Latombe rappelle que ce débat est avant tout politique : il interroge le rôle de l’État, ses choix stratégiques et la manière dont l’argent public est utilisé. Pour lui, les parlementaires ont la responsabilité d’assurer ce contrôle et de fixer une ligne claire.
Il dit qu’il n’a jamais été opposé au programme des start-up d’État, à condition qu’il ne concurrence pas le secteur privé et ne refasse pas ce que les entreprises font déjà. Or, selon lui, la DINUM s’est écartée de cette logique depuis quelques années, en revenant à une approche du « faire » plutôt que de l’« acheter », et donc en se substituant à la filière. Il affirme que cela « tue la filière » et que la politisation du sujet est normale, puisqu’il s’agit précisément d’une question de soutien industriel et économique.
Il ajoute que la DINUM reste une administration, placée sous l’autorité d’un ministre, et qu’il est normal que les parlementaires s’en saisissent. Il souligne qu’il existe désormais une unanimité politique sur ce point, ce qui montre l’ampleur du problème.
Philippe Latombe cite des éléments concrets : le dernier appel d’offres de la DINUM semble surtout bénéficier à de grandes ESN, avec des contrats de plusieurs centaines de millions d’euros. Dans le contexte budgétaire actuel, il s’interroge sur la pertinence de ces dépenses et rappelle d’autres échecs structurels, comme la Plateforme des données de santé, qui a coûté des millions sans produire grand-chose avant d’être entièrement revue — un combat qui a duré cinq ans.
Il exprime enfin une inquiétude plus large : ce qui se passe à la DINUM pourrait se reproduire ailleurs, notamment en cybersécurité, si l’ANSSI se mettait elle aussi à « faire à la place des autres » au lieu de coordonner. Il insiste que l’État doit fixer les règles et organiser, mais pas se substituer au marché : le secteur privé a une agilité et une capacité d’innovation que l’administration n’a pas.
Il conclut que ce débat relève pleinement du domaine politique, car il engage la stratégie nationale et l’avenir de toute une filière.
1:52:30:
Alain GARNIER (Jamespot)
Il explique que, dans le débat autour de la DINUM, certains acteurs du numérique ont pu soutenir publiquement tel ou tel parti, ce qui a pu brouiller la lecture, mais il insiste : le sujet n’est pas partisan. Le Comité stratégique de filière (CSF) a été très clair, et les auditions au Sénat ont montré un consensus transpartisan sur le problème posé par la stratégie actuelle de l’État.
Il dit que, malgré quelques prises de parole mal perçues, la réalité est simple : c’est la filière dans son ensemble qui parle, et elle dit qu’il y a un problème. Pour lui, on le voit depuis le début de la table ronde : les acteurs français du collaboratif sont en croissance, mais leur croissance est freinée dans leur propre pays, ce qui est paradoxal.
Il prend l’exemple d’XWiki, « emblématique » selon lui : l’entreprise connaît une très forte croissance en Allemagne et en Europe, mais moins en France, alors même qu’elle fait partie des acteurs les plus reconnus. Il dit que cela devrait interroger l’État : si l’écosystème national se développe mieux à l’étranger qu’en France, c’est bien la preuve que la stratégie actuelle n’aide pas la filière, même si, personnellement, il se réjouit de cette réussite européenne.
01:54:10
Thierry BAYON
Il demande si ce n’est pas précisément le bon moment pour réaffirmer une stratégie claire : plutôt que de financer des développements internes à l’État, il faudrait subventionner la filière existante, investir dans les acteurs déjà opérationnels et flécher l’achat public vers les solutions françaises.
Il suggère que la commande publique pourrait devenir un levier décisif, notamment dans le secteur du numérique collaboratif, pour soutenir durablement les entreprises de la filière.
1:54:40:
Philippe LATOMBE
Il souligne d’abord que les questions numériques sont, à l’Assemblée comme au Sénat, traitées de manière transpartisane, ce qu’il juge très positif. Il rappelle que la loi « Résilience » a été votée à l’unanimité, tous groupes politiques confondus, ce qui montre que ces sujets dépassent les clivages partisans.
Il ajoute que, puisque le débat porte sur les dépenses de l’État, il assume pleinement que ce soit un débat politique. Il indique d’ailleurs avoir déjà préparé un amendement visant à bloquer ou annuler les quelque 700 millions d’euros d’appels d’offres récemment publiés par la DINUM, en gelant les crédits de paiement si nécessaire.
Pour lui, la conclusion est simple : il faut soutenir la filière. Les acteurs privés doivent pouvoir fonctionner correctement, proposer des solutions pour l’État, et être considérés dans une véritable relation client–fournisseur. C’est ainsi, dit-il, que le secteur privé progressera, et que l’État gagnera en efficacité dans les outils qu’il utilise.
01:56:50
Ludovic DUBOST (XWiki)
Il prend l’exemple du projet OpenDesk en Allemagne pour montrer un modèle qu’il juge efficace : les autorités allemandes ont sélectionné des éditeurs, et chaque déploiement génère automatiquement de l’achat et donc du revenu pour ces entreprises. En plus, le projet finance aussi des développements spécifiques, intégrés proprement dans les logiciels open source.
Il souligne que la DINUM a fait des choix technologiques proches — par exemple en utilisant Elm, également présent dans OpenDesk — mais que l’exécution a été différente : le développement de Chap a été fait de manière « un peu anachronique », avec beaucoup de code custom difficilement réintégré dans le produit open source. Il dit entendre des situations similaires autour de Grist, où le nombre de développeurs mobilisés ne correspond pas vraiment aux contributions effectives au produit, faute d’expertise.
Ludovic Dubost insiste que ce problème vient du modèle lui-même : les développeurs missionnés par l’État ne sont pas forcément experts du produit, donc leurs contributions se réintègrent mal. À l’inverse, les développeurs d’un éditeur comme XWiki ont tout intérêt à ce que chaque développement spécifique bénéficie au produit entier, et c’est ce qu’ils font massivement.
Il conclut que ces modèles étatiques ont un vrai déficit d’efficacité, tandis que les projets où l’État travaille en partenariat direct avec les éditeurs — comme en Allemagne — produisent des logiciels plus solides et une filière réellement renforcée.
Tour de table final
Philippe PINAULT (TALKSPIRIT)
Il remercie d’abord Philippe Latombe pour ses engagements et réaffirme que toute la filière appelle à un soutien clair et sans ambiguïté de l’État. Il insiste sur la qualité des acteurs français : si les entreprises du secteur n’étaient pas bonnes, dit-il, elles ne seraient plus sur le marché, tant celui-ci est difficile et extrêmement concurrentiel.
Il explique que la filière n’a pas besoin avant tout de subventions, mais surtout de visibilité et de commande publique, car c’est l’achat — plus que les aides financières — qui permet la croissance durable. Il appelle donc de ses vœux toutes les initiatives capables de mieux faire connaître les offres françaises et de structurer un marché où les éditeurs peuvent réellement se développer.
Philippe VAL-GRELIER (ALINTO)
Il remercie l’ensemble des participants et souligne que, comme dans beaucoup d’autres secteurs, la filière a besoin avant tout de cohérence et de lisibilité. Pour être efficace, dit-il, il faut d’abord soutenir l’amorçage afin de produire de bons logiciels, car c’est toujours la qualité du produit qui fait la différence. Les aides publiques servent à prendre de l’avance et à assumer le risque, mais elles doivent impérativement être suivies par de la commande publique.
Il insiste sur l’importance d’implanter les solutions françaises là où les utilisateurs découvrent et adoptent les outils numériques : c’est ce qui crée les usages et les habitudes, comme l’avaient montré autrefois le BYOD ou la shadow IT.
Enfin, il appelle à une stratégie politique lisible : les acteurs de terrain, explique-t-il, n’avancent plus parce qu’ils entendent dire qu’« une solution gratuite va arriver », puis ne voient rien venir. Cette incertitude bloque les décisions d’achat — et dans ce vide, ce sont Microsoft et Google, déjà en place, qui gagnent mécaniquement.
Lionel ROUX (WIMI)
Il revient sur le frein psychologique qui pèse encore sur les décideurs lorsqu’il s’agit de sortir de Microsoft. Ce risque perçu, dit-il, explique en grande partie pourquoi la demande reste faible, aussi bien dans le public que dans le privé. Le flux principal continue de partir vers les acteurs américains, faute de déclenchement côté clients.
Pour atténuer cette perception de risque, Wimi a choisi de s’associer à de grands acteurs reconnus, comme Thales dans le secteur défense ou Atos dans le secteur civil, afin de rassurer les organisations et de montrer qu’il existe des alternatives crédibles.
Il souligne enfin que le véritable levier pourrait être réglementaire : prévoir qu’en présence de données sensibles, les organisations soient orientées — au moins pour démarrer — vers des solutions souveraines. C’est, selon lui, ce « petit cran » supplémentaire qui pourrait réellement changer la dynamique du marché.
Samuel LE PORT (Treebal)
Elle reconnaît que la mission est particulièrement complexe et s’interroge sur ce que donneront l’EDIC Digital Commons , ainsi que sur la place que pourra prendre la filière dans ce cadre. Elle réaffirme sa conviction que l’avenir passe par l’open source, construit sur un maillage de PME plutôt que sur de grands groupes. Selon elle, le modèle des multinationales est un mauvais scénario pour l’Europe, et c’est plutôt une dynamique d’entreprises de taille intermédiaire et d’écosystèmes ouverts qui permettra de bâtir une souveraineté numérique solide.
Philippe Latombe insiste sur l’importance d’intégrer pleinement la géopolitique dans l’analyse des risques des organisations. Selon lui, l’Europe doit entamer un découplage progressif vis-à-vis des dépendances critiques envers les États-Unis et la Chine, non pour bannir ces technologies, mais pour réduire une vulnérabilité devenue trop forte. L’exemple VMware, dit-il, n’est qu’un prélude à d’autres chocs à venir si l’Europe ne reconquiert pas la capacité de produire ses propres briques technologiques.
Il estime que le moment d’agir est maintenant : investir, structurer et consolider une autonomie stratégique avant qu’il ne soit trop tard. L’élection de Trump, ajoute-t-il, ne crée pas ces enjeux mais agit comme un révélateur puissant.
Enfin, il rappelle que la France et l’Europe disposent déjà de solutions solides, qu’il faut savoir promouvoir et valoriser : des offres de qualité existent dans le collaboratif comme dans le cloud, et elles doivent être mises en avant autant par conviction que par nécessité stratégique.